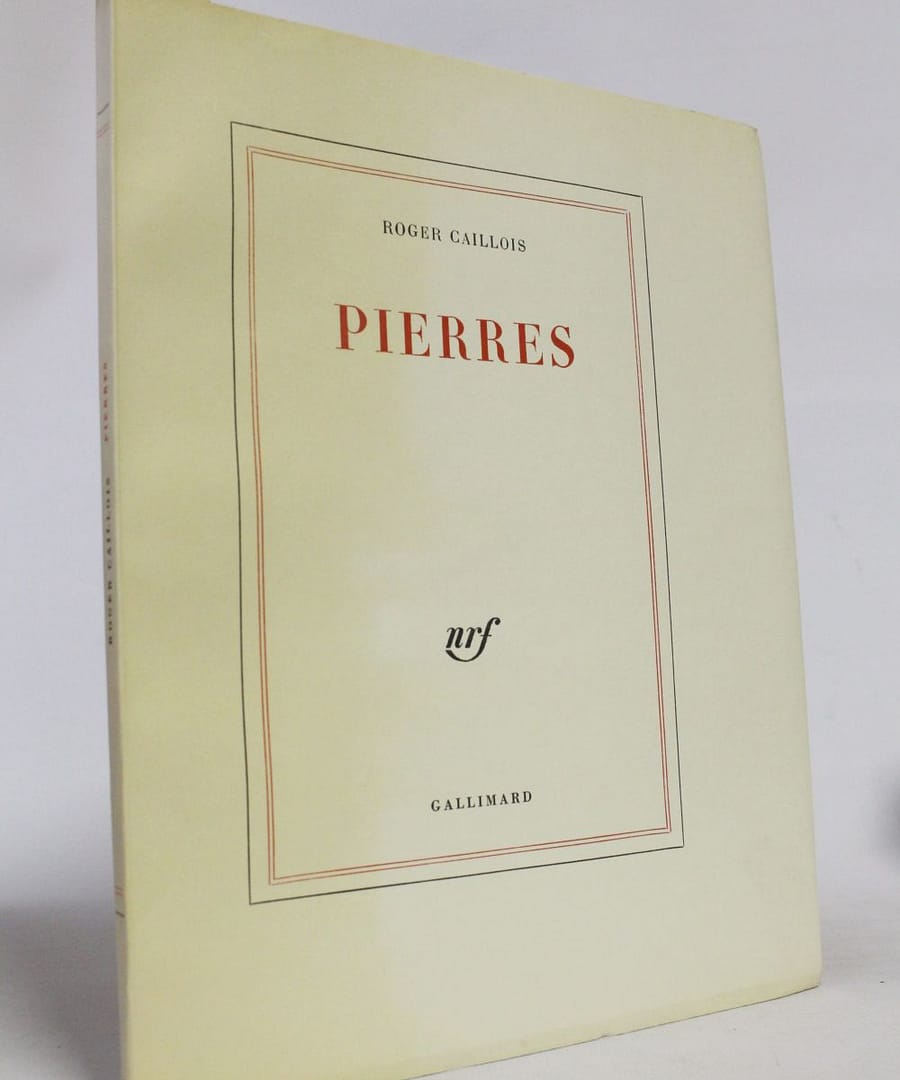J’ai croisé en rêve trois personnages. D’abord il y avait une femme que je conduisais en voiture, elle avait un problème grave, m’a-t-elle expliqué. Elle souffrait d’une maladie étrange, elle était « inflammable », c’est-à-dire qu’elle prenait parfois feu, littéralement. C’était gênant, ses amants portaient des cicatrices de brûlures, ses cheveux étaient secs et cassants et puis elle devait souvent changer de garde-robe. Pour elle, pas de vieux vêtements confortables et appréciés, qui ont pris le pli. Je l’ai déposée devant un imposant bâtiment en briques, d’allure américaine à vrai dire, où elle avait rendez-vous.
Et puis l’autre, qui m’attendait personnellement, était cet homme, celui qui s’enfermait pour feindre d’écrire un livre, jour après jour, sans jamais avouer son mensonge. Peu importait ce qu’il y avait sur les pages qu’il enfermait soigneusement tous les soirs au verrou dans son tiroir, ce n’était pas un livre. Celui-là, je n’étais pas sûr qu’il n’était pas moi, que je n’étais pas lui.
Le troisième personnage était un critique littéraire ; alors que mon roman n’était même pas encore achevé, même pas encore publié, il écrivait déjà un article qui expliquait à quel point ce texte tentait de masquer son néant par une complexité et une abondance de surface.
Parfois, il faut bien conclure que notre inconscient est un ennemi acharné, prêt à toutes les bassesses pour nous nuire.
Mandragore
Sur la tombe de quel enchanteur enseveli en plein bois a poussé cette couronne de tiges tourmentées ? Assurément, leur répartition résulte de quelque disparition. Qui est mort là ?
Est-ce un pendu condamné par un tribunal clandestin, dont l’ultime éjaculation a engendré cette de mandragore torse ?
Quoi, chaque arbre naîtrait d’une mort ou porterait son souvenir ?
Au fond des bois, sont-ce monuments aux morts, statues commémoratives, totems ancestraux qu’ils érigent, tandis que les fougères autour d’eux s’inclinent ?
Photographie P.-A. Touge
L’arbre et son double

Dans ce pays, dont certains assurent qu’il jouxte la forêt Hercynienne, les arbres possèdent tous un double. Non pas leur ombre, quand le soleil baisse, mais pour certains un jumeau inversé, dissimulé sous la terre, exactement identique à celui de la surface, que dessinent leurs racines, comme le rapporte Virgile, dans les Géorgiques. D’autres encore ont pour double un arbre mort, alors qu’ils sont vivants, ou un arbre noir, alors qu’ils sont blancs. Pour eux, ce n’est nullement un présage néfaste, comme il en va pour nous, plutôt une habitude très ancienne.
Photographie de P.-A. Touge
Les arbres de Pline l’Ancien, dans L’Histoire naturelle
Les arbres ont été les temples des divinités; et encore aujourd’hui les campagnes, conservant dans leur simplicité les rites anciens, consacrent le plus bel arbre à un dieu. Et, dans le fait, les images resplendissantes d’or et d’ivoire ne nous inspirent pas plus d’adoration que les bois sacrés et leur profond silence. Chaque espèce d’arbre demeure toujours dédiée à une même divinité, le chêne à Jupiter, le laurier à Apollon, l’olivier à Minerve, le myrte à Vénus, le peuplier à Hercule. Bien plus, les Sylvains, les Faunes, des déesses, des divinités spéciales sont, dans nos croyances, chargés du soin des forêts, comme d’autres divinités président au ciel.
Pline, Histoire naturelle, traduction d’Émile Littré.
Photo, l’arbre sacré d’Otavalo en Équateur.
Vers 1900, Jehan Rictus
Quand tout l’ mond’ doit êt’ dans son lit
Mézig trimarde dans Paris,
Boïaux frais, cœur à la dérive,
En large, en long, su’ ses deux rives,
En Été les arpions brûlés,
En Hiver les rognons cinglés,
La nuit tout’ la Ville est à moi,
J’en suis comm’ qui dirait le Roi,
C’est mon pépin… arriv’ qui plante,
Ça n’ peut fair’ de tort à la Rente.
À chacun son tour le crottoir.
J’ vas dans l’ silence et le désert,
Car l’ jour les rues les pus brillantes,
Les pus pétardièr’s et grouillantes,
À Minoch’ sont qu’ des grands couloirs,
Des collidors à ciel ouvert.
J’ suis l’Empereur du Pavé,
L’ princ’ du Bitum’, l’ duc du Ribouis,
L’ marquis Dolent-de-Cherche-Pieu,
L’ comt’ Flageolant-des-Abatis
L’ baron de l’Asphalte et autres lieux.
J’suis l’baladeur… le bouff-purée,
Le rôd’-la nuit… le long’ ruisseaux,
Le marque-mal à gueul’ tirée
Le mâche angoiss’… le cause-tout haut.
…
Jehan Rictus, Les soliloques du pauvre, « Les Masons ».
Pierres sacrées
Certaines pierres sont divines, images ou habitacles des dieux, déesses elles-mêmes. À Hyette, sur les bords du Céphise, il n’y a que des pierres dans le temple d’Héraklès. Le dieu lui-même est présent dans une pierre informe. À Thespies, on vénère la plus ancienne image de l’Amour. C’est une pierre brute, ni taillée ni polie.
Les bétyles sont des pierres venues du ciel et qui gardent la propriété de se mouvoir librement dans l’air, entourées d’un globe de feu. On leur rend un culte en Achaïe, en Arcadie, en Boétie, en Syrie, à Orchomène et en bien d’autres lieux.
Roger Caillois, Pierres, Poésie/Gallimard.
Si, si à Sées
À l’invitation de l’excellente librairie de l’Oiseau-Lyre, je serai à Sées le 12 décembre, dans les anciennes halles de la ville.
En ce mois souvent consacré aux ripailles, pour la bonne bouche, cet extrait du savoureux Dictionnaire infernal de Collin de Plancy
RAOLLET (JACQUES), — loup-garou de la paroisse de Maumusson, près de Nantes, qui fut arrêté et condamné à mort par le parlement d’Angers. Durant son interrogatoire, il demanda à un gentilhomme qui était présent s’il ne se souvenait pas d’avoir tiré de son arquebuse sur trois loups ; celui-ci ayant répondu affirmativement, il avoua qu’il était l’un des loups, et que, sans l’obstacle qu’il avait eu à cette occasion, il aurait dévoré une femme qui était près du lieu. Rickius dit que lorsque Raollet fut pris, il avait les cheveux flottants sur les épaules, les yeux enfoncés dans la tète, les sourcils refrognés, les ongles extrêmement longs ; qu’il puait tellement qu’on ne pouvait s’en approcher. Quand il se vit condamné par la cour. d’Angers, il ajouta à ses aveux qu’il avait mangé des charrettes ferrées, des moulins à vent, des avocats, procureurs et sergents, disant que cette viande était tellement dure et mal assaisonnée qu’il n’avait pu la digérer.
novembre grippe
Quand la nuit distribue à ses figurants leurs rôles et leurs couteaux, je n’aime pas à me trouver dans une gare de province mal éclairée et déserte. La lueur de veilleuse qui suinte dans les salles d’attente évoque l’insomnie trempée de sueur. Et je pense au malade qui, dans une chambre équivoque, sent venir sa crise cardiaque ou son angoisse crépusculaire. Il est vrai que toujours, à ce moment, un express d’une rapidité inouïe me prend au passage et me dépose en quelques secondes devant une crique étincelante — entre Saint-Raphaël et le Le Trayas.
André Hardellet « Film (en partie censuré) », La Cité Montgol, Poésie/Gallimard.
Tous ces signes pointent vers quelque chose, mais vers quoi ?
DANS LA LETTRE
L’abri, c’est magistral, à l’intérieur d’un a, par egzemple, d’un o, d’un i — intérieur mince, bien sûr, que celui de l’i, mais combien certain, tiède même, gemütlich. Avec ça bien sûr, on ne va pas loin sur le chemin de la renommée. Bien plutôt, on va lentement. Oh combien d’écrivains et combien d’écrivaines
qui sont partis joyeux pour des courses lointaines
à l’intérieur d’un i se sont ensevelis.
Si l’on est désinvolte, on peut choisir autre chose : l’aleph, l’oméga, le sampi.
Ah petit troupeau, petit troupeau, que tu nous fais souffrir.
Raymond Queneau, Texticules, Contes et propos, Folio Gallimard.